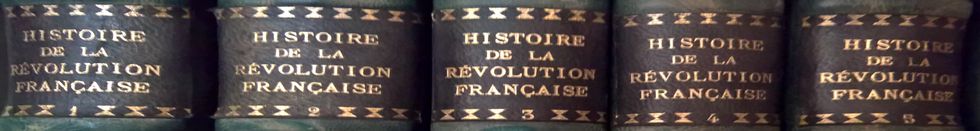Ce 30 octobre, à l’Assemblée nationale, les députés
continuent de discuter, comme ils le font déjà depuis de nombreux jours, sur l’avenir
des biens du clergé.
Une motion un peu particulière a retenu mon attention, c’est
celle de Monsieur Target. Celle-ci concerne l’instruction publique et
nationale. Elle se résume ainsi « A quoi bon faire d’aussi belles lois, si elles ne sont pas comprises »
M. Target fait la motion suivante concernant l'instruction
publique et l'éducation nationale (1) :
(1) Le Moniteur ne fait que mentionner la motion de M.
Target.
Ecoutons-le :
"Messieurs, l'Assemblée nationale exerce la plénitude du
pouvoir législatif ; la liberté de la nation consiste à n'obéir qu'aux lois qui
lui sont données par les citoyens qu'elle a choisis elle-même ; mais c'est
surtout à cet empire qui vient de la persuasion, que l'Assemblée doit aspirer.
Des idées nouvelles ne sont pas toujours facilement saisies par un peuple
accoutumé aux procédés du gouvernement absolu ; ou s'il vient à les détester
autant qu'ils le méritent, il est à craindre qu'il n'évite pas toujours l'excès
contraire. Quel est le préservatif de ces dangers qui bordent la route que nous
avons à parcourir ? L'instruction ! C'est la législation des esprits ; elle fait
descendre sur le peuple la sagesse de ses représentants ; elle éclaire quand la
loi commande ; elle plie les mœurs ; elle accommode les idées aux besoins de la
révolution ; elle donne aux décrets qu'il faut observer, la puissance des pensées
que l'esprit humain produit de lui-même et qu'il embrasse comme son propre
ouvrage ; enfin, dans le temps des intrigues, des fausses rumeurs, des
séductions accumulées, des maximes pernicieuses, c'est l'instruction qui doit
venir au secours de la vérité outragée et ramener la paix : elle renverse
également les projets des esclaves et des despotes. Le moment est donc venu où
notre premier devoir est d'instruire.
Il ne faut point ici de hautes conceptions ni de principes
métaphysiques. Nous avons besoin du ton simple et familier de la vérité qui
persuade en se montrant et qui se rend visible à tous les yeux. Les
représentants de la nation n'ont pas de plus beau ministère à remplir, puisqu'il
est le plus utile. L'Assemblée nationale n'y perd rien en respect, elle y gagne
beaucoup en amour."
Son projet de décret est néanmoins étonnant car il se divise
en deux parties très différentes :
La première partie consiste à nommer des rédacteurs qui
rédigeront des sortes de notices explicatives des textes de loi. Vous devez
bien vous douter (comme moi) que rédiger ce genre d’explications à une population
qui en grande partie ne sait pas lire et qui pire encore, dans de nombreuses
régions de France ne parle ni ne comprend le Français ; c’est comment
dire, un peu inutile.
Voici le texte de cette première partie :
"L'Assemblée nationale arrête que le comité de rédaction
fera choix de cinq de ses membres, lesquels seront chargés de rédiger sur
chacun des décrets importants de l'Assemblée, de soumettre à son jugement, de
faire ensuite imprimer à un très-grand nombre d'exemplaires, publier et distribuer,
dans tout le royaume, des instructions simples, précises et familières, dans
lesquelles les principes seront mis à la portée de tous, et la sagesse des décrets
rendue sensible."
La seconde partie est un peu plus sérieuse, puisqu’elle
propose que « L'Assemblée arrête également que les mêmes commissaires
prépareront un plan d'éducation nationale et d'instruction publique, et qu'ils
en communiqueront avec les membres du comité de Constitution, pour porter ensemble
ce travail au degré de perfection dont il est susceptible. »
Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1877_num_9_1_5259_t1_0612_0000_4
Voici l'échange qui va s’en suivre entre les députés. Je
me suis permis d’y insérer mes commentaires :
M. Le Chapelier. J'observerai sur cette motion qu'il est
infiniment dangereux de faire soi-même le commentaire de sa loi, et que les commentaires
attaquent toujours et détruisent souvent les lois.
M. Garat aîné. Je l'avoue, les commentaires des commentateurs
étrangers à la loi sont destructeurs de la loi ; ou ils ne la connaissent pas
ou ils cherchent à égarer plutôt qu'à instruire. Mais lorsque les commentateurs
sont les législateurs eux-mêmes, peut-on conserver ces craintes ? Instruire les
peuples et les conduire à l'obéissance par la raison, c'est leur rendre le plus
grand de tous les services.
Instruire les peuples pour les conduire à l’obéissance par
la raison ? Cela ne vous choque-t-il pas un peu ?
M. Mougins de Roquefort. Je demande que la motion soit
divisée et que l'Assemblée statue sur la partie qui concerne le plan
d'éducation nationale.
Voilà qui est raisonnable ce me semble.
M. de Montlosier. La motion est aussi inutile que
dangereuse. Il n'y a pas lieu d'y donner suite.
Inutile et dangereuse ? L’instruction publique ?
M. le Président consulte l'Assemblée, qui décide qu'il n'y a
pas lieu à délibérer quant à présent.
Circulez, il n’y a plus rien à voir.
Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1877_num_9_1_5259_t1_0612_0000_10
Un mot sur l’instruction publique sous l’ancien régime ?
L’instruction publique est à la charge de l’Eglise. Celle-ci se targue d’avoir 600 collèges, réservés
à la bonne bourgeoisie parce que coûteux, et 30.000 écoles paroissiales
réparties sur les 37.000 paroisses. Avec de tels chiffres on est en droit de
se demander comment se faisait-il que 85 % de la population soit analphabète !
En fait la plupart de ces écoles ne se contentaient que d’apprendre le catéchisme
aux enfants, qui de toute façon devaient les quitter très vite dès 7 ans
(parfois plus tôt encore), pour aller travailler.
Pour en apprendre beaucoup plus, je vous conseille la lecture du texte extrait du livre de l'historien Hervé Grevet. Il vous suffit de cliquer sur l'image ci-dessous :
Les deux problèmes des députés
Les députés se rendent bien compte que s’ils veulent que
leurs lois soient appliquées, il faudrait pour le moins qu’elles soient
comprises. Cela nécessite une population de citoyens sachant lire et de plus
étant capables de comprendre ce qu’ils lisent, ce qui implique, outre l’apprentissage
du français dans les deux tiers du royaume, celui de disciplines
complémentaires, comme l’histoire ou la géographie. Il est également
indispensable que les bons citoyens de cette France régénérée sachent compter,
si l’on veut qu’ils deviennent de bons commerçants et de bons contribuables.
Ce projet philanthropique peut néanmoins en effrayer
quelques-uns. Imaginez que des citoyens un peu trop curieux se mettent à lire
Voltaire et finissent par éclater de rire devant les dogmes religieux, ou qu’ils
deviennent friands des articles publiés par le dérangeant Marat !
Le second problème, et il est de taille, c’est que l’éducation
est depuis des siècles le domaine réservé de l’Eglise ! Et l’Eglise
maîtrise bien le domaine. Elle sait comment donner la meilleure instruction
possible à ceux qui peuvent payer (mais sous certaines conditions), et comment
maintenir le peuple dans une ignorance crasse en ne lui apprenant que la
crainte de l’enfer, à force d’histoires aussi fantaisistes qu’abominables. L’Eglise,
elle, sait remettre un insolent à sa place quand celui-ci ne retire pas son
chapeau, au passage d’une procession. Elle le fait arrêter, torturer,
décapiter et brûler, en allumant même son bûcher avec des ouvrages de Voltaire,
comme elle le fit en 1766 pour le malheureux jeune chevalier de la Barre.
La Révolution a encore besoin de l’Eglise
Beaucoup de nos députés de la Constituante sont des
Voltairiens et la religion ne les effraie plus. Ils s’apprêtent même à la
dépouiller de tous ses biens pour renflouer les caisses de l’Etat, ce qui leur
évitera de devoir prélever des richesses aussi bien à l’aristocratie qu’à
eux-mêmes. Mais ils ont encore besoin de l’Eglise. Ce sont les curés qui lisent
à leurs fidèles les décrets de l’Assemblée (du moins pour le moment). Ce sont
les curés qui tiennent les registres d’état civil. Et ce sont les curés qui
malgré tout assurent ce semblant d’éducation nécessaire aux pauvres. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle la nouvelle constitution civile du clergé va doubler le salaire de ces curés, reconnus officiellement comme des fonctionnaires de l’Etat !
Le projet concernant une instruction publique obligatoire et
gratuite se construira donc très difficilement et durant une période qui ira bien
au-delà de la Révolution ! La loi Falloux du 15 mars 1850 renforcera le
rôle des religieux dans l'organisation de l'enseignement scolaire. Il faudra la
salvatrice loi du 9 décembre 1905, pour que la religion commence à relâcher progressivement
son emprise sur l’éducation des enfants.
L’Assemblée constituante ne fera pas grand-chose
Le 13 octobre 1790, à la suite d'un rapport de Talleyrand sur l’instruction publique,
l’Assemblée décrétera :
« 1° qu'elle ne s'occupera d'aucune des parties de
l'instruction, jusqu'au moment où le comité de Constitution, à qui elle
conserve l'attribution la plus générale sur cet objet, aura présenté son
travail relatif à cette partie de la Constitution ;
« 2° Qu'afin que le cours d'instruction ne soit point arrêté
un seul instant, le roi sera supplié d'ordonner que les rentrées dans les
différentes écoles publiques se feront cette année encore comme à l'ordinaire,
sans rien changer cependant aux dispositions du décret sur la constitution du
clergé, concernant les séminaires ;
« 3° Elle charge les directoires des départements de faire
dresser l'état et de veiller, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, à
la conservation des monuments des églises et maisons devenues domaines
nationaux, qui se trouvent dans l'étendue de leur soumission ; et lesdits états
seront remis au comité d'aliénation ;
« 4° Elle commet au même soin, pour les nombreux
monuments du même genre qui existent à Paris, pour tous les dépôts de chartes,
titres, papiers et bibliothèques, la municipalité de cette ville qui s'associera,
pour éclairer sa surveillance, des membres choisis des différentes académies. »
Sources :
Les 10, 11 et 19 septembre 1791, la constitution achevée et à la veille de se séparer, Talleyrand lira à l'Assemblée, son plan sur l’instruction
publique, dans lequel il proposera que la Nation offre à tous le grand bienfait de l’éducation, mais ne l’impose à personne.
Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49002n.image
La Convention travaillera plus
Il faudra attendre la Convention et surtout la première
République pour que le projet d’instruction obligatoire et gratuite progresse.
Le 20 avril 1792, Condorcet présentera son Rapport et
projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique, prônant un système éducatif laïc avec une égalité entre les filles et les garçons devant
l'instruction.
Source : https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1989_num_42_4_1898
En décembre 1792, le député Ducos,
déclarera à la Convention : « je ne sais quel degré d’importance on
attache à l’établissement des écoles primaires ; je pense, pour moi, que
nous leur devrons notre véritable régénération, l’accord des mœurs et des lois,
sans lequel il n’y a point de liberté. »
Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48889h
Le 18 juin 1793, Robespierre demandera que l’on ajoute
l’instruction commune, aux droits divers garantis par la constitution.
24 Juin 1793, la première constitution républicaine de
la France stipulera en son article 22 :
« L'instruction est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l'instruction à la portée de tous les citoyens. »
Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
Le 26 juin 1793, Lakanal présenta un Plan d'éducation
nationale au nom du comité d'instruction publique. (En attendant qu’il y ait de vraies écoles, Lakanal permettra aux particuliers d'enseigner à titre personnel et de recevoir en contrepartie
une pension de l'Etat).
Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48937j.image
Le 3 juillet 1793, la Convention mettra en place, sur la
proposition de Robespierre une Commission d'instruction publique de six membres
(Philippe Rühl, Joseph Lakanal, Henri Grégoire, Jacques-Michel Coupé, Louis Antoine de Saint-Just et André Jeanbon Saint André. Les deux
derniers seront remplacés le 10 juillet par Léonard Bourdon et Robespierre. Élargie à dix
membres, elle s'intitulera Commission d'Éducation nationale.
Le 13 juillet 1793, Robespierre lira à la tribune de la
Convention le Plan d’éducation de Michel Le Peletier de Saint-Fargeau. Celui-ci
avait été assassiné 6 mois plus tôt, le 20 Janvier 1793, pour avoir, le jour
même, voté la mort de Louis XVI. Le Peletier était d’accord avec Condorcet
concernant les 3 degrés supérieurs de l’enseignement mais il voulait organiser
le 1er degré d’enseignement de façon que tous les enfants, même les
plus pauvres, reçoivent un commencement sérieux d’éducation. Il instituait également
le monopole de l’Etat, alors que l’éducation était jusqu’alors le domaine
réservé de l’Eglise, et qu’il le restera encore très longtemps après la
Révolution.
Le plan de le Peletier de Saint Fargeau était quelque peu
spartiate ! La République prendrait à sa charge tous les enfants de 5 ans
à 11 ans pour les filles et de 5 à 12 ans pour les garçons. Tous, sans
distinction et sans exception, seraient élevés en commun dans des internats,
des « maisons d’éducation » et « sous la saine loi de l’égalité,
recevraient mêmes vêtements, même nourriture, même instruction, mêmes
soins ». Certains adversaires de la Révolution comparent ce plan de Le
Peletier de Saint Fargeau, avec la révolution culturelle chinoise qui voulait
endoctriner les enfants contre le passé et par là-même leurs parents. Ils
semblent oublier que cette idée a été proposée par un aristocrate et que c’est
une habitude courante dans les élites de mettre ses enfants dans des
pensionnats de Jésuites par exemple), dans lesquels ils portent des uniformes
et intègrent les valeurs de leur caste.
Le 29 juillet 1793, Robespierre présentera son Projet de
Décret sur l’Education Publique :
- Art. I. Tous les enfants seront élevés aux dépens de la
République, depuis l’âge de cinq ans jusqu’à douze pour les garçons, &
depuis cinq ans jusqu’à onze pour les filles.
- II. L’éducation nationale sera égale pour tous ; tous
recevront même nourriture, mêmes vêtements, même instruction, mêmes soins.
Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48992p
Le 21 octobre 1793, la Convention décrètera l’instauration d’une école primaire
publique d’État.
Le 19 Décembre 1793, la Convention n’adopta finalement ni le plan de Condorcet ni
celui de Le Peletier. Comme ce dernier, elle ne s’occupa que des « premières écoles ».
L’enseignement restera libre. Le père de famille enverra ses enfants pendant 3
ans au moins à l’école de son choix. La République subventionnera les maîtres
qui devront avoir un certificat de civisme. Ce sera donc un système scolaire
libéral, décentralisé mais contrôlé par l’État qui sera adopté.
Quant aux écoles supérieures, voici juste un exemple. À la suite de la décision du 11 mars 1794 par la Convention de créer une école centrale de
travaux publics. L’école polytechnique sera créée le 28 septembre 1794. Elle
sera civile et gratuite et on y entrera par un concourt ouvert dans les 22
principales villes de la République. Une fois la Révolution vaincue, Napoléon
rendra cette école d’excellence, militaire et payante.
Un mot sur la Convention
Vous prendrez conscience, lorsque nous y arriverons, de tous les progrès qui ont été initiés par la Convention, comme l'abolition de l'esclavage ou le suffrage universel. Certains lui reprochent de ne pas les avoir tous mis immédiatement en application, comme la fameuse constitution du 24 Juin 1793. C'est oublier que la France était en guerre, en guerre contre toute l'Europe, et en guerre contre des armées contre-révolutionnaires sur ses arrières. C'est la raison pour laquelle les mises en application de nombre de loi étaient suspendues, comme il est souvent d'usage en temps de guerre (Voir la proclamation de l'Etat de siège du 2 Août 1914).
Mais de tout cela, nous reparlerons, lorsque le temps sera venu.