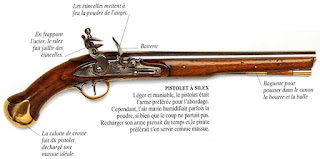Je vais essayer d’être concis et je ne vais pas vous rendre
compte de l’intégralité du projet de Necker, ni du détail des débats qui ont
suivi et qui ont duré jusqu’à la fin décembre !
Les plus curieux ou les plus studieux, disposeront néanmoins
à la fin de l’article de tous les liens permettant d’y accéder.
J'agrémente cet article avec de magnifiques gravures à la gloire du grand Necker. Necker a en effet bénéficié, tout comme en 1781, d'un certain culte qui s'est manifesté par la diffusion de nombreuses estampes ; une forme de propagande, à n'en point douter.
Vous pouvez également lire le commentaire que Marat fait de l'intervention de Necker, dans le numéro 51 du mercredi 18 novembre, dans son journal L'Ami du Peuple. (Cliquez ici)
Le ministre des finances, le banquier suisse Jacque Necker,
a demandé à être reçu par l’Assemblée nationale, afin qu’il puisse rendre
compte auprès des députés, de l’aggravation des finances du pays et de proposer
ses solutions. La situation financière du royaume va effectivement en empirant !
L’argent ne rentre plus dans les caisses de l’Etat. La vente des biens du
clergé n’a pas encore commencé, les impôts ne sont pas payés, ou alors avec
beaucoup de retards (les agents du fisc n’osent pas trop insister vu l’ambiance
un peu « agitée »), les taxes supprimées, comme la gabelle, n’ont pas
encore été remplacées et les barrières d’octroi incendiées en juillet n’ont pas
encore été remises en service. Les deux emprunts que Necker avait lancés en
août, 30 millions le 9 et 80 millions le 27, ont échoué. Quant à la
contribution patriotique égale à un quart du revenu et ne touchant que les
revenus supérieurs à 400 livres, sans oublier les dons patriotique, ils
ramèneront tout juste 1 million de livres (une goutte d’eau). A noter également
que le prix du blé a doublé par rapport à 1788, à cause des récoltes
insuffisante et que l’Etat en achète de grande quantité à l’étranger.
Le ministre a mis à jour les comptes. Il estime selon sa
formule « sans aucune certitude » à 80 millions « le secours
extraordinaire, indispensable pour suppléer au déficit extraordinaire et
momentané de l'année 1790 ». De plus, ces 80 millions seront à ajouter au
moins aux 90 qui sont nécessaires pour achever le service de l’année 1789 et
s'acquitter avec la caisse d'escompte. Necker réclame donc en tout 170 millions
devant l’Assemblée !
Necker a bien sûr une solution. Il va proposer que cet argent
soit prêté par la Caisse d'escompte, qui, après avoir été transformée en Banque
Nationale, émettrait 240 millions de papier-monnaie en contrepartie du nouvel
emprunt et des 70 millions déjà dus. Cette émission de papier monnaie serait
rendu possible du fait que la Banque nationale disposerait d’un capital de 150
millions servant de caution ! Ce serait donc une forme de création
monétaire. Nous sommes loin du ratio des banques actuelles qui ont le droit de
prêter de l’argent, c’est-à-dire de créer de la monnaie scripturale, jusqu’à
12.5 fois l’équivalent de leur capital, voire beaucoup plus pour certaines
grandes banques ! Pour mémoire, de nos jour, l’argent liquide ne
représente que 10% de la monnaie en circulation, les 90% restants étant de
l’argent scriptural, c’est-à-dire des lignes d’écritures, ou plutôt de codes
informatiques.
« Il y a de plus, aujourd'hui, des circonstances particulières qui concourent à la rareté du numéraire. Notre ancienne balance de commerce avec les pays étrangers, balance toujours favorable à la France, est dérangée par diverses causes. Nous avons importé cette année des quantités immenses de blé, et nous demandons encore aux pays étrangers de nouveaux secours ; notre traité de commerce avec l'Angleterre nous rend débiteurs, envers ce royaume, d'une somme de marchandises manufacturées que nos propres fabriques fournissaient autrefois. »
Concernant cette balance du commerce extérieure, je vous
renvoie à la lecture de mon article du 12 novembre, dans lequel je traite dans
le détail du déséquilibre des échanges commerciaux entre la France et la Grande
Bretagne, résultant de l’avance technologique des Anglais et surtout du traité
commercial franco-britannique "Eden-Rayneval"
de 1786.
« Les étrangers, intimidés par les circonstances, s'éloignent de nos fonds publics, et au lieu d'y employer annuellement une portion de leurs capitaux, plusieurs, depuis quelque temps, cherchent à s'en défaire, et tout au moins ils n'y replacent pas les intérêts que nous leur payons, et nous sommes obligés de leur en remettre les fonds en entier. Les voyageurs étrangers sont détournés par nos troubles intérieurs de venir en France, et nous avons perdu pour un temps l'introduction de numéraire que leurs grandes dépenses dans le royaume occasionnaient. »
Aujourd’hui on dirait que les marchés financiers n’ont plus
confiance et les agences de cotations baisseraient la note de la France, ce qui
augmenterait les taux d’intérêts des emprunts faits par l’Etat.
« Enfin, ce que peut-être on n'a jamais vu, même aux époques les plus fatales de la monarchie, une émigration prodigieuse, toute composée de gens riches ou aisés, attire dans l'étranger, non-seulement des fonds proportionnés aux dépenses des citoyens qui nous quittent, mais encore une partie de leurs capitaux disponibles. »
 |
| Les premiers fuyards |
Dès le 16 juillet, des Grands du royaume, tels que Madame de Polignac, la favorite de la reine, le Prince de Condé, le Maréchal de Broglie et même le frère du roi, le comte d’Artois (le futur Charles X), se
sont enfuis à l’étranger. Et depuis, l’émigration des nobles continue (je vous rappelle qu’un certain nombre châteaux ont été
incendiés de-ci de-là en France). L’effet de cette émigration se voit plus
particulièrement à Paris.
Nous avions lu ce que Colson écrivait dans son courrier du 8 novembre adressé à son ami de province :
« Où en serions-nous (...) si l'émigration ne nous emmenait 120 ou 150 000 âmes de Paris, l'affiche dont je viens de parler ayant évalué à un 7ème ou un 6ème de la population ce qui en est sorti depuis la seule époque du mois d'août et en étant, outre cela, sorties tous les jours des foules nombreuses pendant le mois de juillet à compter du 12 ? ».
Notons d'ailleurs que Colson relevait le côté positif de cette
réduction de la population, compte tenu du manque cruel de pain dans la
capitale !
 |
| La fuite des émigrés |
Si je puis me permettre, voilà ce qui arrive à une économie dont la principale source
de revenus repose sur le luxe, c’est-à-dire sur la fabrication de choses
inutiles à la vie quotidienne d’un citoyen. L’économie anglaise était florissante
parce qu’elle fabriquait alors avec ses nouvelles machines mécaniques, des choses
utiles, comme de modestes poteries ou de simples tissus pour l’habillement. En temps de crise, le luxe ne sert plus à rien.
« Je dois citer encore une cause de la rareté de l'argent, non pas dans le royaume, mais dans la circulation : c'est le retard du payement des impôts, retard qui retient inutilement dans une multitude de mains, les espèces qui doivent servir aux dépenses publiques, et se diviser ensuite de nouveau par les consommations. »
« Enfin, les temps de divisions, les temps où l'esprit de parti se déploie avec une grande force, donnent lieu quelquefois aux séquestres de l'argent, par le seul désir de gêner la circulation et de produire un embarras qui amène un surcroît de confusion, propre à changer la situation des affaires et la scène des événements. Il existe donc une grande diversité de causes particulières qui, avec les causes générales, concourent à la rareté du numéraire, rareté qui s'accroît ensuite par elle-même, parce que la crainte de manquer d'argent, comme la crainte de manquer d'une denrée nécessaire, engage ceux qui en ont à se ménager une double provision. »
Dans tous les périodes de crise, les gens ont effectivement tendance à mettre leur argent à l’abri.
Vous pourrez lire l’intégralité du mémoire de Monsieur Necker, par le lien ci-dessous :
Je vous donne à lire sa touchante conclusion :
« Pardonnez, Messieurs, si en vous parlant d'affaires j'y mêle souvent les sentiments de mon cœur ; elles seraient insupportables, ces affaires, si rien de moral, si rien de sensible ne pouvait s'y réunir : et quel citoyen ne serait animé, quel homme ne serait agrandi par la contemplation du but auquel vous désirez d'arriver ? vous ne rejetterez donc point l'hommage que l'on se plaît à vous rendre de ses sentiments, de ses vœux et de ses pensées, et ce serait avec peine que je me soumettrais, si vous le vouliez, au sacrifice de tous les mouvements de mon cœur, et que je me réduirais à vous offrir, en tout temps, le langage de la simple raison ; mais cette raison n'est jamais complète lorsque le sentiment en est absolument séparé, parce que lui seul peut recueillir une infinité de vues qui échappent, même dans les affaires, aux efforts et aux atteintes de l'esprit. »
Encore Mirabeau !
Peut-être vous souvenez-vous que le 26 septembre dernier, Mirabeau avait convaincu les députés à voter "de confiance", le plan de redressement proposé par Necker. "De confiance", principalement en raison du fait que probablement peu de députés avaient les connaissances nécessaires pour juger du bien fondé et de l’efficacité des propositions de Necker, qui de par sa profession de banquier maitrise toutes les subtilités de la finance. Mirabeau semble les avoir, si l’on en juge à la qualité de ses interventions en réponse à ce nouveau plan de Necker.
Mais cette fois-ci, Mirabeau va être en désaccord avec Necker. Rappelons-nous également qu’il était déjà intervenu le 6 novembre dernier pour critiquer ce système de création de papier monnaie !
Il avait protesté « La caisse nous inonde d'un
papier-monnaie de l'espèce la plus alarmante, puisque la fabrication de ce
papier reste dans les mains d'une compagnie nullement comptable envers l'Etat,
d'une association que rien n'empêche de chercher, dans cet incroyable abandon,
les profits si souvent prédits à ses actionnaires. »
Et il avait pris cet exemple pour étayer sa protestation « Les
fermiers ne sauraient comment employer les billets de la caisse d'escompte. Ces
billets ne servent pas à payer des journées de travail ; et s'il faut que
l'habitant de la campagne accumule pour payer ses baux, accumulera-i-il des
billets ? Ce n'est que l'argent à la main qu'on peut aller ramasser le blé dans
les campagnes, et dès lors les avances deviennent impossibles, si les espèces
effectives sont toujours plus difficiles à ramasser. »
Le 20 novembre, Mirabeau interviendra à la barre de l’Assemblée,
pour exprimer son désaccord avec la possibilité de soumettre le crédit de
l'Etat au bon vouloir d'une banque privée qui aurait le privilège de créer de
la monnaie. L’Assemblée se ralliera à son point de vue, de confiance…
N’étant pas encore certain de vous rapporter le détail de ce
débat dans les semaines à venir, je vous communique ci-dessous, les liens s’y
rapportant, et ce jusqu’à décembre, c’est-à-dire jusqu’au décret amendé du 21
décembre 1789 sur les assignats-monnaie. Parce que oui, au final, tout ce débat
aboutira à la création des assignats, dont il faudra bien parler, mais en temps
voulu !
Projet pour la création d'un papier monnaie, par M. Lalande, lors de la séance du 5 décembre 1789
Discussion sur le premier projet de décret sur les finances, lors de la séance du 17décembre 1789
Second projet de décret sur les finances, lors de la séance du 17 décembre 1789
Motion de M. le comte de Pardieu, lors de la séance du 18 décembre 1789
Discussion suite au projet d'arrêté de M. Ricard de Séalt, lors de la séance du 18décembre 1789
Décret du 19 décembre 1789 sur la caisse d'escompte
Décret du 19 décembre 1789 sur la caisse de l'extraordinaire
Protestation de M. Bergasse contre les assignats-monnaie, lors de la séance du 19 décembre1789
Décret sur la caisse d'escompte, amendé le 21 décembre 1789
Décret sur les assignats-monnaie, amendé le 21 décembre 1789
 |
| Source : Musée Carnavalet |