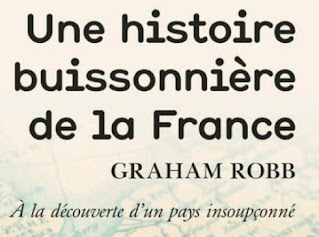Il y a eu ce jour à l’Assemblée nationale constituante, deux interventions très importantes.
La première fut celle du ministre des Finances, Jacques
Necker, la seconde fut celle de Pierre Samuel du Pont de Nemours.
La première est celle d’un banquier devenu ministre, qui
analyse la situation désastreuse des finances avec un œil de comptable et
apporte des solutions de comptable.
La seconde est celle d’un intellectuel, qui analyse la
situation d’un point du vue politique et apporte une solution que le premier ne
pouvait en aucun cas imaginer.
Les discours sont passionnants, mais extrêmement longs. J’ai
donc essayé de vous rendre l’esprit de chacun, de la façon la plus concise que je
le pouvais. Je vous conseille cependant de les lire en entier grâce aux liens
que je vous donne.
Discours de Monsieur Necker :
Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1877_num_9_1_5042_t1_0139_0000_6
 |
| Jacques Necker |
Jacques Necker commence par décrire la
situation à présent totalement catastrophique, des finances du royaume. Une
situation tellement alarmante, que ce ne sera plus la peine de lancer un nouvel
emprunt si on n’arrive pas à rassurer les banquiers en prenant des mesures
urgentes. Il avoue que c’est le roi qui l’a poussé à exposer clairement la
situation aux députés de l’Assemblée, lui disant : « qu'il valait mieux tout dire, qu'il valait mieux découvrir, pendant qu'on aperçoit
encore la possibilité du secours, la crise extrême où se trouvent les
finances ».
On apprend même que c’est Necker qui a suggéré au roi de
donner sa vaisselle d’argent à la monnaie, afin de pallier au manque de numéraire,
ce que le roi a accepté avec empressement, suivi aussitôt par son épouse
Marie-Antoinette.
Necker le dit lui-même, il ne propose « aucune grande
subversion, aucune idée systématique, aucune de ces imaginations auxquelles on
donne le nom de génie » pour remettre de l'ordre dans les finances. Il
affirme que : « tout doit être simple en ce genre, tout doit être au
moins successif, surtout dans un moment où la confiance, ce lien si nécessaire
entre le présent et l'avenir, nous refuse son assistance ». Toujours ce
souci de rassurer les financiers prêteurs.
Dans la première partie de son intervention, relative aux
revenus et dépenses fixes, on apprend même que le Roi et la Reine sont disposés
à n'avoir qu'une seule et même maison ; et qu’en ordonnant les retranchements
les plus rigides : « Leurs Majestés, guidées par le plus vif désir de
contribuer au rétablissement de l'ordre, espèrent pouvoir réduire à 20 millions
les dépenses comprises sous la dénomination générale de maison du Roi ; ce qui produirait
une nouvelle économie de 5 millions ».
Dans la seconde partie, relative aux besoins
extraordinaires, Necker suggère qu'il serait préférable de demander une
contribution extraordinaire en raison du revenu annuel, et qu'elle pourrait
être portée au quart de ce revenu libre de toute charge, de tout impôt et de
toute rente. Il s’agit en quelque sorte d’un impôt sur le revenu.
Il ne voit à propos de cet impôt exceptionnel sur le revenu qu'une
seule difficulté importante. Elle concerne le genre de déclaration qu'il faudrait
exiger de toutes les personnes assujetties à une taxe qui serait relative aux
revenus particuliers de chaque contribuable. « Le serment » dit-il, « est sans doute le lien le plus fort ; mais dans une transaction qui n'aura lieu
qu'une seule fois, dans une transaction à laquelle la majeure partie des
habitants du royaume seront appelés à participer, est-il convenable de les
mettre tous, et sans exception, aux prises avec leur conscience ? Est-il
convenable de les exposer à manquer de respect envers l'Etre suprême, et de des
dégager ainsi, peut-être pour toute leur vie, les liens qu'ils auront une fois
rompus ? Le serment ne doit être employé que pour fortifier les obligations
attachées à des fonctions nécessaires ; mais quand un serment doit être imposé
à tous les habitants d'un royaume, quand leur fidélité est visiblement en
contraste avec leur intérêt enfin, quand ce serment n'a pour but qu'une
disposition momentanée et purement pécuniaire, vous ne serez point surpris,
Messieurs, de la répugnance du Roi pour une telle condition ; et malgré les
exemples qu'on met en avant, Sa Majesté désire que votre attention se fixe
particulièrement sur ces observations. La formule suivante : Je déclare avec vérité
que ..... serait peut-être suffisante ; et c'est un bel hommage à rendre à une
nation, que de ne lui demander rien de plus. » N’est-ce pas touchant ?
Et ceci, qu’en dites-vous ? : « Je
considérerais comme une facilité générale et nécessaire, de permettre à tout le
monde indistinctement d'acquitter sa taxe en vaisselle ou en bijoux d'or et
d'argent, reçus à un prix favorable pour les contribuables. La femme d'un
simple paysan donnera, s'il le faut, son anneau ou sa croix d'or ; elle n'en
sera pas moins heureuse, et il lui sera permis d'en être fière. »
N'est-ce pas charmant ?
Le discours est intelligemment argumenté et se veut
optimiste, ce qui semble pour le moins vital s’il veut rassurer les banques.
Mais Necker, malgré ses idées progressistes, est un homme de l’ancien monde. Il
n’invente rien de nouveau, « aucune grande subversion, aucune idée
systématique, aucune de ces imaginations auxquelles on donne le nom de génie »,
selon ses propres termes.
Le mérite du discours de Necker est de réussir à faire redescendre sur terre, les députés de l'Assemblées nationale, qui se sont un peu égarés ces derniers temps dans le monde idéal des idées.
Discours de Monsieur du Pont de Nemours.
Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1877_num_9_1_5042_t1_0147_0000_1
 |
| Pierre Samuel du Pont de Nemours |
J’ai commencé à lire l’intervention de Monsieur du Pont de Nemours, par
curiosité. Mais progressivement j’ai pris conscience de l’importance de
celle-ci. Car du Pont de Nemours a une perception plus fine de la société qui
va lui permettre de proposer une solution tout à fait nouvelle, qui de plus,
aura des conséquences sur la société (et sur le cours de la Révolution).
Il commence ainsi :
« Messieurs, entraîné par mon zèle à cette tribune, je
ne puis m'empêcher d'être effrayé d'avoir à vous parler après un orateur si
célèbre, et qui vous est si cher, sur un si grand nombre de choses, si
importantes et si compliquées, dont il n'en est aucune qui ne demandât, de
votre part, la plus profonde réflexion, et par rapport auxquelles l'excès du
danger vous force de vous décider avec promptitude, et pour ainsi dire à
l'instant même.
Le mal est bien grand, puisqu'un ministre, aussi justement
honoré de votre estime et de celle du peuple que le premier ministre des
finances, appelle au secours tant d'efforts divers, et contre l'océan de
calamités qui nous menace ne dédaigne pas, pour réparer la digue entrouverte et
prête à s'écrouler, d'employer toute espèce de matériaux, depuis la roche
pesante et difficile à remuer, jusqu'au sablon qui coule entre les doigts. »
Modestie d’abord, mais scepticisme ensuite, quant aux moyens de Necker, qui ressemblent à ceux du désespoir (utiliser du sable pour consolider
une digue !).
Dupont de Nemours ne conteste pas les chiffres de Necker,
mais il doute de l’efficacité réelle de cet impôt exceptionnel d’un quart des
revenus. Il explique :
« Quand vous supposeriez que la masse imposable peut s'élever jusqu'à un milliard, vous trouveriez encore que ce milliard est disséminé sur un nombre immense de propriétaires, dont la plupart sont très-pauvres, et totalement hors d'état d'ajouter aux impositions que déjà ils ont à supporter, l'imposition, même passagère, d'un quart de leurs revenus. Quelques riches le pourraient ; notre zèle nous porterait tous à nous soumettre volontairement ; mais tel qui en prendrait l'engagement, aurait beaucoup de peine à le remplir, et parmi vos commettants, il n'y en a qu'un fort petit nombre par rapport auxquels on y puisse songer.
Je croirais exagérer beaucoup si j'accordais que dans les revenus libres il y en ait trois cents millions qui appartinssent à des propriétaires assez riches pour en payer le quart. »
Il ajoute un peu plus loin :
« Nous croyons en général, Messieurs, qu’il y a beaucoup de riches, parce que nous vivons au milieu d'eux ; j'ose vous assurer que leur nombre est très petit. »… « L’enthousiasme suffit pour voter, mais il n'y a que la richesse qui puisse payer ; et la richesse suffisante, pour payer un quart de ses revenus, ne me paraît pas exister à présent chez la plupart de nos riches. Il est évident qu'elle n'est pas chez nos pauvres ».
Le moment de bascule...
Du Pont de Nemours a travaillé son sujet. Il semble connaître
l’état des finances du pays aussi bien que Necker, sinon mieux. Son très long
discours est complété de très longues notes justificatives. Son discours prend
une nouvelle orientation au moment où il dit ceci :
« Rappelez-vous, Messieurs, ces jours mémorables où les ministres de la religion, nobles et bienfaisants comme elle, ont reconnu qu'après Dieu l'on ne peut adorer que la patrie ; où ils vous ont dit, par la bouche du prélat vertueux qu'ils avaient choisi pour organe : « Que la religion soit respectée ; que les devoirs du culte soient remplis avec décence ; que les pauvres soient soulagés, et nous remettons notre sort personnel entre les mains d'une nation généreuse »
Ils ne seront point trompés dans leur attente ; la nation, qui est rentrée dans la jouissance de leurs trésors avec respect, saura les répartir avec justice, avec sagesse, avec un amour filial. Il y a trop longtemps qu'une disproportion révoltante existait entre la fortune des divers pasteurs des âmes qui remplissent avec d'égales vertus un ministère également saint. »
Va s’en suivre une très longue et très précise description
de l’état des revenus et biens du clergé.
Le ton est donné lorsqu’il affirme :
« Le clergé a fait son devoir : il l'a fait avec noblesse, avec piété, avec générosité, avec confiance ; mais c'était un devoir.
Les dîmes sont donc à la nation ; elles sont à la disposition de vous, Messieurs, qui la représentez. »
Plus loin :
« Je ne vous ai encore parlé, Messieurs, que de la moindre partie des richesses que le service de la religion justement satisfait, laissera pour sauver l'Etat.
Les respectables ministres des autels qui vous ont montré dans cette salle à quel point ils étaient citoyens avant d'être pontifes, et combien ils le sont demeurés depuis, n'ont point mis de bornes à leur zèle patriotique. Ils se sont donnés à vous, eux et leurs biens ; ils se sont remis de leur sort à la générosité de la nation, qui gravera dans ses fastes leur dévouement et leurs expressions nobles et touchantes. »
Le ton change quelque peu dans le passage suivant :
« Lorsque des hommes se réunissent pour former une société civile, et mettent en commun une partie de leurs forces pour garantir mutuellement leurs propriétés, et pour en étendre l'usage, ils donnent l'existence au premier et au plus grand des corps moraux ou politiques, l'Etat. Si, dans la suite, ils instituent des corporations d'un ordre inférieur, ils ne le sont et ne le peuvent faire que sous la condition expresse ou tacite qu'elles seront conformes au bien de l'Etat, qu'elles auront pour but son utilité. Des corporations nuisibles à l'Etat seraient un attentat contre lui, elles seraient en guerre plus ou moins ouverte avec lui, et il ne pourrait leur reconnaître, bien moins encore leur garantir une propriété, car la guerre n'est autre chose que la disposition où sont les belligérants de ne pas reconnaître, de ne pas respecter la propriété les uns des autres, et les actes qu'ils font en conséquence pour la détruire.
Tant que l'Etat ou le corps politique de la nation approuve ou tolère une corporation inférieure, cette corporation a une existence morale et politique ; elle peut posséder, recevoir, transmettre des propriétés ; ces propriétés sont, comme les autres, sous la garantie commune ; et tout citoyen qui les violerait, serait puni comme s'il portait atteinte aux propriétés d'un autre citoyen.
Mais si une corporation devient ou paraît dangereuse pour l'Etat, la nation qui n'a pu aliéner le droit de pourvoir au meilleur service et au plus grand bonheur de tous ses membres, peut détruire la corporation ; et dès lors les propriétés dont elle a joui, qui n'étaient à aucun des autres citoyens, puisque la corporation avait droit, tant qu'elle subsistait, de les défendre contre eux, ces biens deviennent une propriété indivise de la société, qui seule a le droit d'en faire l'usage le plus utile au bien général.
Ces maximes sont si essentiellement raisonnables, qu'elles servent de règle, même avant qu'on les ait analysées. Les jésuites subsistaient il y a trente ans en France : leur corporation avait des propriétés, et ils étaient reçus à les défendre en justice. L'autorité publique qui existait alors, a dissous la corporation ; personne n'a trouvé injuste que les biens fussent mis sous la main du public ; on a seulement réclamé les droits des créanciers qui avaient prêté de bonne foi à une corporation légalement existante, et les droits individuels de chacun des membres de cette corporation à un traitement alimentaire.
Le clergé a été un corps très-légalement existant : il a été anciennement le second, puis le premier ordre de l'Etat. Il était une grande corporation composée d'une multitude d'autres petites corporations, et chacune de celles-ci pouvait avoir des propriétés. La corporation générale pouvait en avoir aussi ; elle en avait ; elle levait sur ses membres des décimes qui étaient une propriété indivise de son ordre. Elle contractait avec des officiers. Elle était une république dans l'empire.
Le clergé, il faut le dire quoique à regret, puisque le fait est exact, le clergé n'a pas fait un bon usage de cet état de corporation. Je prie ses membres que j'honore, dont je respecte les lumières, dont j'admire l'éloquence et les talents, dont je révère le zèle, dont je chéris la vertu, de me pardonner ce que je suis obligé d'exposer ici : je ne l'impute à aucun d'eux ; il n'y en a aucun qui fût capable de la suite de résolutions anti sociales auxquelles leur ordre s'est porté : le tort n'en est pas moins à eux, il est uniquement à l'esprit de corps, qui est l'opposé de l'esprit public. Le clergé a tantôt esquivé, tantôt nettement refusé la contribution qu'il devait pour les besoins de la patrie. Cette conduite de sa part est très-moderne, elle ne date que de quatre-vingt-trois ans, mais elle a été poussée très loin, et les conséquences en sont très funestes. Si depuis 1706, le clergé eût contribué, non pas comme le peuple, on ignorait encore, l'année dernière, que cela fût juste, mais comme la noblesse, dont les privilèges étaient les seuls qu'il réclamât, il en résulterait dans nos finances une différence de deux milliards sept cents millions de capital ; il en résulterait non-seulement que nous n'éprouverions aucun déficit, mais qu'on eût pu remettre au peuple les impositions les plus onéreuses, sans remplacement et sans indemnité. (Voyez dans la pièce justificative, à la fin, la preuve de cette assertion.) Il est vrai que la faiblesse du ministère a singulièrement coopéré à ce mal public ; mais le ministère n'aurait pas eu cette faiblesse, si le clergé n'eût pas été une corporation. »
Il se fait encore plus clair en affirmant tout bonnement :
« Les biens du clergé sont donc à vous, c'est-à-dire à la nation, qui vous a confié ses pouvoirs. »
Dupont de Nemours va jusqu’à critiquer la médiocre qualité
des services que l’Eglise est sensée assurer :
« Nous savons tous que l'administration de la charité est très imparfaite, et que le système de l'éducation publique est tout à fait mauvais.
Nous savons que dans les hôpitaux, on fait avec beaucoup de zèle et de dépense, avec un courage héroïque et une angélique vertu de la part des sœurs infirmières, peu pour le besoin, rien pour la consolation, gui est le premier besoin de l'infortune et de la mauvaise santé. J'ai indiqué ailleurs quelques moyens pour opérer beaucoup plus de bien moral et physique, à moins de frais. (Voyez un petit ouvrage intitulé : Idées sur la meilleure manière de secourir les pauvres malades dans une grande ville, imprimé chez Moutard).
Nous savons, quant aux collèges, combien l'éducation y est pédantesque, chargée de mots, vide de choses, dénuée des connaissances qui peuvent être utiles à la société, et que nous sommes entièrement privés de livres véritablement classiques.
Il y a donc une multitude d'établissements utiles à faire, depuis les simples écoles des campagnes, les pensionnats des petites villes et les collèges des moyennes, jusqu'aux universités des grandes. »
(…)
« Ainsi toutes les raisons les plus puissantes et les plus irrésistibles se réunissent pour constater, Messieurs, que les biens du clergé, de quelque nature qu'ils soient, n'ont été qu'en dépôt entre ses mains, et qu'ils appartiennent à l'Etat, sous la seule condition de pourvoir honorablement à l'entretien du culte et de ses ministres, et de conserver, d'améliorer même les établissements de charité ou d'instruction.
Pardonnez-moi, Messieurs, l'espèce de dissertation politique et théologique, dans laquelle je me suis trouvé engagé pour rendre cette vérité palpable. »
Sur la base de ce constat, Du Pont de Nemours commence à
énumérer une longue liste d’actions destinées à redresser rapidement les
finances.
La vente des biens-fonds du clergé, ouvrira selon son
expression, « un emploi avantageux et sûr aux capitaux libres ». L’Etat
n’aura même pas à se presser. Il pourra jouir provisoirement des revenus, et il
pourra attendre en chaque lieu des offres convenables. Il assure qu’il y aura
rapidement des offres pour les édifices et les terrains des villes,
particulièrement de la capitale, où les maisons religieuses occupent les plus
beaux emplacements. Il y a dans Paris pour 40 millions au moins de ces édifices
inutiles, à réaliser en trois mois !
Il propose d’utiliser la Caisse d’escompte, qui bénéficie d’une
confiance certaine du fait que les porteurs de ses billets bénéficient de ses
engagements. Sur 40 millions en écus qui y seront déposés, il assure que l’Etat
pourra disposer de 100 à 120 millions de billets.
Dupont de Nemours est lui aussi très optimiste, puisqu’il affirme
qu’au 1er janvier 1791, le déficit aura non seulement été supprimé, mais que l’Etat
aura augmenté de cinq millions les fonds de l'éducation publique ; soulagé le
peuple de cinquante-cinq millions des impositions les plus odieuses, et de plus
de trente-cinq millions de frais de perception, de frais de procédure, de frais
de vexations qu'elles entraînaient avec elles ; qu’il aura assuré pour six
millions d'encouragement à l'agriculture et au commerce ; établi un fonds d'amortissement
de vingt-cinq millions ; mis dix millions en réserve pour les cas fortuits, préparé
un fonds de guerre de quarante-huit millions , destiné à s'accroître tous les
ans ; et sur les cent quatre-vingt-neuf millions de revenu créé ou libéré, il restera
à l’Etat encore vingt-quatre à disposition !
Concernant ces 24 millions à disposition, Dupont de Nemours presse
la sollicitude des députés en les priant d’employer ce revenu :
« à supprimer toutes les impositions des journaliers dans les campagnes, des compagnons et des petits artisans dans les villes, de tous ceux qui habitant dans la maison d'autrui, n'y occuperont qu'un logement au-dessous d'un certain prix de loyer »
« Il est cruel de demander une imposition à l'homme pour qui la vie elle-même est une pesante charge, à laquelle il a peine à pourvoir. Il est absurde de la demander au salarié à qui l'on ne pourra s'empêcher de la rendre en augmentation de salaire. La subsistance est pour tout le monde un créancier impitoyable et privilégié ; ce n'est qu'après avoir satisfait à ce qu'elle exige que l'on peut songer aux autres besoins. La société doit protection à l'indigent, comme elle doit secours à l'infirme, avec une entière gratuité ; car la société est composée d'hommes dont aucun n'existe que par l'effet des secours gratuits, dont on a comblé son enfance. Je vous avais demandé, Messieurs, de faire entrer cette sainte maxime dans la déclaration des droits. N'y a-t-il pas encore place ?
Mais ce n'est pas seulement l'humanité, c'est l'intérêt bien entendu, qui exige que vous ayez des citoyens prolétaires, quittes envers la patrie quand ils lui ont donné des enfants, quand ils ont concouru de leurs suffrages au choix des hommes qu'ils jugent capables de les représenter, quand ils ont, dans le besoin, aidé, de leur personne, à la sûreté commune. Il est même raisonnable et utile encore, qu'après les citoyens prolétaires, les simples habitants qui ne tiennent à l'Etat par aucune propriété foncière, qui n'ont pour subsister que leur travail, qui peuvent, à volonté, porter ce travail dans tous les lieux où ils le trouvent plus lucratif, et qui ne pourraient, sans injustice, être privés de cette liberté, ne soient obligés, ni à des contributions dont la matière leur manque, ni à perdre leur temps, soit pour concourir à la répartition de ces impositions qu'ils ne payeront pas, soit à la direction des travaux publics qui ne s'exercent point sur les héritages dont ils sont dénués, soit à la garde des propriétés que leurs parents ne leur ont point transmises et qu'ils n'ont pu encore acquérir. L'homme de cette classe doit être libre et heureux ; il est prêt à tout dans la société ; il y peut parvenir à tout par le travail, par l'économie, par les bonnes mœurs ; mais il n'y est pas encore quelque chose ; la société est faite pour lui, il n'est pas encore fait pour elle ; et son propre intérêt demande que ce soient ceux qui ont à perdre, qui s'occupent de conserver, et ceux qui ont eu le loisir et les moyens d'acquérir le plus d'instruction, que l'on charge de la répandre. »
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je n’ai
plus rien à ajouter...
Merci d’avoir lu ce très long article.